Repris de
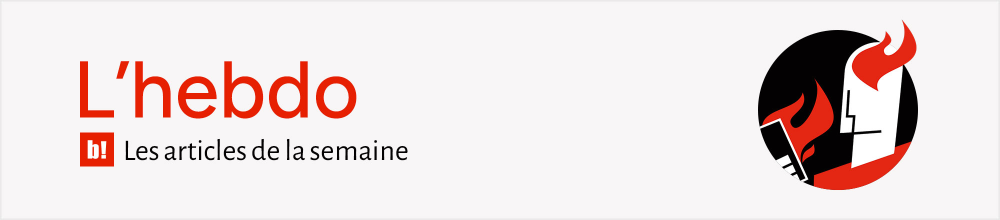
Le long combat de Sophie, lanceuse d’alerte des crèches privées People & Baby
Son combat entre dans sa seizième année : l’éducatrice avait lancé l’alerte sur les dérives des crèches privées de l’entreprise People & Baby. Elle entend faire reconnaître des faits de discrimination syndicale lors d’une audience le 3 février.
par Tiphaine Guéret
2 février 2026 à 16h00, modifié le 3 février 2026 à 16h26

Yeux charbonneux et verbe haut, Sophie s’exprime d’une voix éraillée qui trahit ces métiers où l’on parle à longueur de journée. On la rencontre un soir de janvier dans un café de Paris, emmitouflée dans un épais pull noir dont elle remonte le col pour se protéger du froid.
Éducatrice de jeunes enfants, Sophie tutoie la cinquantaine. À peu de choses près, un tiers de sa vie a été traversé par l’affaire qui nous occupe : le combat qui l’oppose depuis seize ans à son ex-employeur, l’entreprise gestionnaire de crèches privées People & Baby – au cœur de plusieurs scandales ces dernières années – et au sujet duquel une audience de renvoi après cassation doit trancher ce mardi 3 février.
L’histoire remonte à 2010. Sophie travaille alors dans une crèche privée gérée par People & Baby, située rue Giono, dans le 13e arrondissement de Paris. Elle y occupe aussi une fonction de représentante syndicale de la CNT-Petite enfance. Le 2 mars, cinq employées sont mises à pied à titre conservatoire pour manquement aux règles d’hygiène et de sécurité. Quatre d’entre elles sont par la suite licenciées.
Mises à pied au lendemain d’une grève
Or, les travailleuses incriminées, syndiquées à la CNT, rejettent en bloc ces accusations et dénoncent des faits de répression syndicale : le 1er mars, soit la veille de leur mise à pied, elles étaient en grève.
Une interprétation confirmée par les prud’hommes en 2017, puis par la Cour de cassation en 2023 – après un revers en appel en 2021. En face, People & Baby campe sur ses positions, renvoyant une fois de plus l’affaire devant les tribunaux. L’enjeu pour l’entreprise : rejouer le match. Car sans saisi de la Cour d’appel de renvoi, c’est le jugement des prud’hommes qui serait retenu. Et si la Cour de cassation a bien reconnu la répression syndicale, elle a tout de même donné raison à l’entreprise sur un point : le licenciement pour abus de droit de grève d’une des salariées. Contactée, par Basta!, l’entreprise rappelle sa victoire en appel et ajoute qu’« il ne [lui] appartient pas de [se] prononcer sur cette procédure qui est en cours » et qu’elle souhaite laisser « la justice faire son travail dans le respect de l’ensemble des parties ».
Un temps, Sophie a voulu croire que le débarquement du patron et fondateur du groupe Christophe Durieux, en 2024 par les actionnaires, mettrait un mouchoir sur l’affaire. Ce n’est pas ce qu’il s’est passé. À quelques jours d’une nouvelle audience, la syndicaliste lâche : « C’est de l’acharnement. J’ai parfois le sentiment d’être la dernière coureuse d’un marathon beaucoup trop long… »
Une « considération pour l’enfant »
Fille d’une mère laborantine et d’un père professeur, Sophie aurait pu ne jamais travailler pour People & Baby. Ni même en crèche. Formée en histoire à la fac, puis à l’enseignement avant d’abandonner l’IUFM (ancêtre de l’actuel Inspé), Sophie découvre le milieu de la petite enfance à la naissance de son aîné. Une première expérience « au plus bas de l’échelle »dans une crèche de l’Yonne la confronte à « la maltraitance des enfants et des professionnelles ».
En 2004, à 28 ans, elle se réinstalle à Paris où elle a grandi et entreprend d’obtenir un diplôme d’éducatrice de jeunes enfants. Dans le même temps, elle est embauchée à la crèche de la rue Giono. La structure est alors gérée par une association. Pour Sophie, « Giono » représente tout l’inverse de ce qu’elle a connu jusqu’ici : « Il y avait cette considération pour les professionnelles et pour l’enfant, l’idée que tout doit partir de lui, que je n’ai jamais revue ailleurs ensuite. »
Un système qui « maltraite les bébés »
L’idylle ne dure pas. En 2006, la Ville de Paris, propriétaire des locaux, lance un appel d’offres et confie l’exploitation de la structure à l’entreprise People & Baby en établissant un cahier des charges et en gardant la main sur les horaires, dans le cadre d’un marché de prestations de service. Au mitan des années 2000, le secteur de la petite enfance est aux premières heures de sa privatisation ; People & Baby fait partie de la poignée d’entreprises créées dans la foulée qui s’engouffrent dans la brèche.
On est encore loin des révélations du journaliste Victor Castanet, qui dissèquera dans son livre-enquête Les Ogres (Flammarion, 2024) les ravages d’un système « qui maltraite les bébés », où People & Baby occupe une place de choix.
L’heure n’est pas encore aux nombreuses affaires qui écorneront l’image de l’entreprise, parmi lesquelles la mort, en 2022 dans une crèche de Lyon, de Lisa, 11 mois, forcée par une professionnelle à ingérer un produit caustique. Personne, non plus, n’a pour le moment mis le doigt sur les flots d’argent public captés par People & Baby, qui alerteront l’association anticorruption Anticor. Pourtant, dès 2006, Sophie et ses collègues s’inquiètent du glissement qui s’opère.
« Remplir la crèche et manager »
Dans sa crèche, Sophie évoque une « lente dégradation » : « Quand le groupe arrive, on nous fait peu à peu comprendre que, qu’importe si un enfant pleure, il faut en priorité nettoyer les biberons. Avant, on endormait les enfants dans les bras, on laissait trente minutes de battement aux parents pour les déposer ou les récupérer en se disant qu’il y avait toujours une raison valable à ces retards. Tout ça, c’est fini, l’enfant n’est plus au cœur du projet. Les préoccupations, c’est : remplir la crèche et manager. »
En 2009, ce délitement progressif convainc l’équipe de monter une section syndicale « pour se protéger ». Rapidement, les rapports se crispent avec la direction. Dans ses conclusions dans le cadre de la procédure aux prud’hommes, Rachel Spire, avocate des travailleuses, évoque « la volonté de l’employeur de renouveler l’équipe d’éveil et de sanctionner [les salariées] en raison de leur activité syndicale en suite d’une plainte de la Ville ». Il est aussi question de « convocations arbitraires des salariées par la direction, décidée à “mettre la pression” ».
« On prenait des décisions collectives et on agissait »
Mais c’est un autre élément, la modification des horaires d’accueil, à l’initiative de la Ville, et donc du temps de travail des salariées, qui met le feu aux poudres et débouche sur la grève du 1er mars 2010. Sophie, elle, n’y prend pas part : ce jour-là, elle est en congé, à plusieurs centaines de kilomètres de la capitale.
Le timing de la mise à pied de ses cinq collègues grévistes interroge alors jusqu’à l’inspecteur du travail. De plus, aucun reproche « en matière d’hygiène et de sécurité » n’avait auparavant été formulé, d’après les travailleuses incriminées. L’entreprise récuse quant à elle toute relation entre ces sanctions et l’action syndicale et défend l’absence d’atteinte au droit de grève.
Pour Sophie et ses camarades, c’est le début d’un bras de fer avec People & Baby pour la réintégration des salariées mises à pied. La syndicaliste se souvient d’une période « d’exaltation » : « On prenait des décisions collectives et on agissait. » Les travailleuses occupent pendant plusieurs jours le siège de People & Baby, situé avenue Hoche (8earrondissement), contraignant la direction à quitter les locaux sous les yeux médusés des agents de sécurité.
« On détonnait clairement avec l’image qu’on se fait habituellement des travailleuses de la petite enfance, douces et souriantes », se remémore Sophie, sourire bravache aux lèvres. Cette action lui vaudra une tentative de licenciement de la part de son employeur, finalement mise en échec par l’inspection du travail, Sophie étant protégée par son statut de représentante syndicale.
Rembourser 45 000 euros à l’entreprise
Si elle célèbre la joie dans la lutte, la syndicaliste ne tait rien des souffrances endurées. Après ce combat collectif intense, elle a beau s’y être préparée, « la descente a été raide », admet-elle. Les reproches de son ancien employeur ont aussi laissé des traces durables : « Cet acharnement m’a fragilisée : je n’ai plus été aussi sûre de moi au travail. »
Et puis, il y a la question de l’argent. À bout, Sophie finit par quitter l’entreprise en 2013, quelque temps après son retour d’un arrêt maladie « prescrit par un psychiatre ». S’ensuit une période de vaches maigres, où elle accumule trois mois de loyers impayés et nourrit ses enfants au moyen de bons alimentaires.
En 2017, la société est finalement condamnée aux prud’hommes, notamment pour le traitement qu’elle a réservé à Sophie. Le répit est de courte durée : en 2021, la Cour d’appel confirme la décision concernant son cas mais réduit les indemnités perçues, la contraignant à rembourser 45 000 euros.
Il lui faudra alors attendre deux longues années avant que la Cour de cassation ne demande à l’entreprise de reverser cet argent. Un plan de sauvegarde de la société ayant depuis été activé, People & Baby n’a, pour l’heure, pas restitué l’intégralité de la somme.
« Il faut que ça s’arrête »
À l’approche de la nouvelle audience, Sophie est « préoccupée » : « Seize ans, c’est long, il faut que ça s’arrête. » Si elle tient, dit-elle, c’est grâce à son « socle ». Ses « camarades », son frère, qui l’a soutenue financièrement, mais aussi son compagnon actuel, rencontré au cours de la lutte et avec lequel elle vit entre la Dordogne et Paris – où elle travaille à présent dans une crèche municipale. Sans oublier son amie d’enfance, Louise, qui l’a épaulée à chaque instant et témoigne de son « admiration pour le combat que Sophie continue de mener ».
Alors que l’échange touche à sa fin, Louise a rejoint Sophie. Lorsqu’on demande à cette dernière quel regard elle porte sur les scandales qui éclaboussent aujourd’hui People & Baby, c’est Louise qui répond : « Cela fait seize ans que Sophie et ses collègues disent que ça va finir par arriver… »

