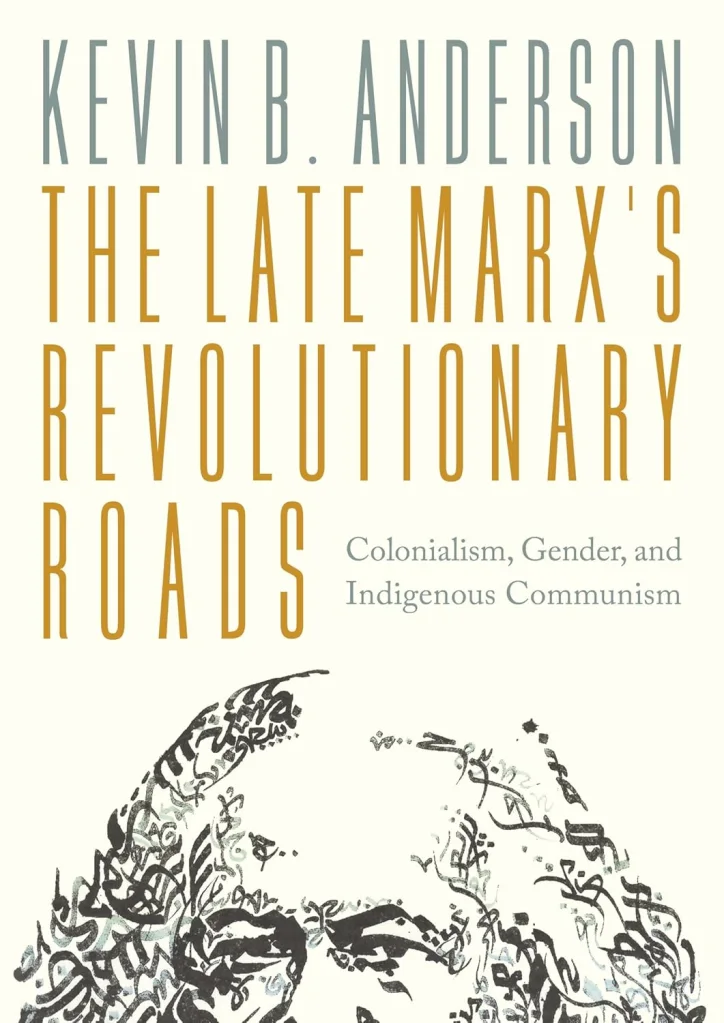
Que nous apprend l’œuvre tardive de Marx sur le rôle des luttes anticoloniales et autochtones dans le dépassement du capitalisme ? Quelles sont les trajectoires révolutionnaires de notre époque ?
Le sociologue et militant politique Kevin Anderson évoque son dernier livre et les récentes manifestations aux États-Unis.
Grusha Gilayeva : Verso a récemment publié votre nouveau livre, The Late Marx’s Revolutionary Roads: Colonialism, Gender, and Indigenous Communism (Les voies révolutionnaires du Marx tardif : colonialisme, genre et communisme autochtone). Il fait suite à votre ouvrage Marx at the Margins (Marx en marge, 2010), qui traitait de l’évolution de la pensée de Marx sur l’autodétermination nationale, l’ethnicité et les sociétés non occidentales au cours de sa vie et de son œuvre. Votre nouvel ouvrage examine de près les carnets ethnologiques de Marx, notamment des documents sur les tribus iroquoises d’Amérique du Nord, les communes rurales indiennes et russes, les anciennes communautés celtiques d’Irlande, etc. Ensemble, ces livres révèlent la complexité de la pensée de Marx, au-delà de toute forme de réductionnisme. Et pourtant, pourquoi devrions-nous lire Marx aujourd’hui, et quel Marx ?
Kevin Anderson : Marx, le plus grand et le plus important critique du capitalisme, revient sur le devant de la scène depuis le début du XXIe siècle, ou du moins depuis la Grande Récession. Ce livre ne doit donc probablement pas être lu isolément [de ses autres travaux]. D’autres discussions, telles que la critique de l’économie politique ou l’analyse de la menace fasciste d’un point de vue marxiste, méritent également notre attention. Mon livre est plutôt une réponse à certaines critiques de Marx formulées au cours du dernier demi-siècle, à partir de la publication de l’ouvrage d’Edward Said, Orientalism (1978). Dans les milieux universitaires et intellectuels en général, lorsque l’on évoque Marx, les gens ne disent généralement pas « j’aime le capitalisme, donc Marx a tort » ou « le capitalisme fonctionne très bien, que cela nous plaise ou non. Par conséquent, Marx a tort et est dépassé ». Dans les universités [américaines], on entend plus souvent dire que Marx était un homme blanc du XIXe siècle qui ne comprenait pas les questions de genre, de race ou même de colonialisme, et encore moins la sexualité au sens des questions LGBTQ+ ou des questions autochtones – toutes ces préoccupations contemporaines qui motivent une grande partie des mouvements radicaux. Marx est souvent jugé en dehors de ces discussions. Il existe ensuite un groupe plus restreint mais en pleine expansion qui s’identifie davantage à Marx, mais qui affirme qu’il faut plutôt se concentrer sur les questions de classe et d’économie. Ces groupes, que l’on pourrait qualifier de partisans de Bernie Sanders et de partisans de la diversité, de l’équité et de l’inclusion (DEI), se disputent entre eux. J’ai entendu des universitaires dire : « Pourquoi ces hommes blancs veulent-ils toujours parler de classe ? »
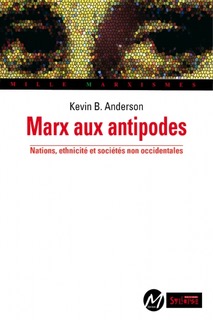
Je viens d’une tradition marxiste qui parlait déjà de lier ces questions il y a longtemps, autour de la Seconde Guerre mondiale. C’était une petite tendance [organisée autour de CLR James, Grace Lee Boggs et Raya Dunayevskaya], mais sur la base de ce fondement intellectuel, en particulier celui fourni par Dunayevskaya, j’ai toujours considéré Marx comme un penseur multidimensionnel. J’ai mené des recherches approfondies sur ce sujet il y a environ 25 ans. Au cours de la dernière décennie, plusieurs autres chercheurs et moi-même avons tenté de montrer que dans ses derniers écrits, Marx abordait beaucoup de ces questions, par exemple dans ses textes sur la guerre civile américaine, où il traite des questions de race et de classe. Il ne s’agit pas de prouver que Marx n’était pas aussi mauvais qu’on le pensait et qu’on doit simplement poursuivre nos mouvements tels qu’ils sont actuellement. Bien sûr, Marx a toujours eu une critique très profonde du capital et des classes, donc
ma recherche montre qu’en nous intéressant à Marx, on est obligés de regarder le capitalisme, on est obligés de regarder non seulement au niveau local, mais aussi au niveau mondial. Nous devons simplement examiner ces grandes théories qui permettent de comprendre le monde, mais cela n’empêche pas d’être très précis sur une société particulière, une lutte particulière, une ethnie, un genre ou une orientation sexuelle particulière. Nous devons donc trouver un moyen de combiner tout cela.
De nombreuses pensées critiques et radicales ont eu tendance à exclure le capital et les classes sociales de toute réflexion sérieuse. Il y a quelques années, je mettais sur pied un programme interdisciplinaire de premier cycle et je ne trouvais aucun cours sur les classes sociales à l’UCSB. Je suis dans le département de sociologie, et il n’y avait pas de cours régulier sur les classes sociales, ni même sur la stratification sociale. Et dans toute l’université, il n’y avait pas un seul cours dont le titre contenait le mot « classe » ou même « inégalité économique » qui était régulièrement dispensé aux étudiants de premier cycle. Il en va de même, dans une certaine mesure, pour le programme annuel de l’Association américaine de sociologie. J’espère que mon travail et celui d’autres personnes comme Heather Brown, Kohei Seito, August Nimtz, Marcelo Musto, David Smith et Andrew Hartman (avec son nouveau livre Karl Marx in America) commenceront à changer le discours. Aujourd’hui, on ne peut plus dire aussi facilement ce que Cedric Robinson dit contre Marx dans son livre [Black Marxism: The Making of the Black Radical tradition, 1983] sans ajouter au moins une note de bas de page précisant que Marx a peut-être été vraiment problématique sur certaines questions au début, mais qu’il a peut-être surmonté cela dans ses écrits ultérieurs.
Grusha Gilayeva : Quelle est la relation entre les différents Marx et la lutte contre le fascisme ?
Kevin Anderson : Il existe de nombreuses théories de gauche sur le fascisme, mais je pense que les deux meilleures sont la théorie du colonialisme et la tradition développée par Trotsky, que l’on retrouve également chez des auteurs comme Erich Fromm, même si les gens ne se rendent pas compte du lien qui existe entre les deux. Commençons par la seconde. Selon Trotsky et Erich Fromm, ce qui différencie le fascisme des mouvements réactionnaires antérieurs, c’est qu’il dispose d’une base populaire dans la classe moyenne inférieure, la petite bourgeoisie. Le fascisme a donc un attrait populiste en ce sens. En tant que gauchistes( militants de gauche), nous devons donc nous intéresser à cette base sociale et essayer de la détourner du fascisme vers la gauche. La théorie du colonialisme racialisé – je pense qu’Aimé Césaire est l’un des premiers à l’avoir exprimée – soutient que ce qu’Hitler a fait en Europe était déjà largement pratiqué dans les colonies. On peut citer l’exemple le plus évident, celui du roi Léopold au Congo. Les Britanniques et les Français n’étaient pas en reste en matière de brutalité. Tout l’aspect racial du projet colonial, tout ce racisme et cet antagonisme racial, combinés à la forme moderne et racialisée d’antisémitisme qui couvait depuis longtemps dans la culture occidentale, ont éclaté au grand jour avec le fascisme. Ces deux théories ne se rejoignent pas beaucoup, mais elles devraient. Elles reproduisent en quelque sorte les grands débats contemporains au sein de la gauche que j’ai mentionnés.
Grusha Gilayeva : Dans votre livre, vous affirmez également que Marx a changé sa conception de la transformation révolutionnaire, qui part désormais de la périphérie plutôt que du cœur capitaliste. Pourquoi pensez-vous qu’il a fait cela ?
Kevin Anderson : Bien sûr, il y a eu des soulèvements contre le colonialisme bien avant cela, mais prenons-en quelques-uns. À l’époque de Marx, dans les années 1850, il y a eu la révolte des Taiping en Chine, qui n’était pas vraiment anticolonialiste, mais qui s’est tout de même déroulée dans une région semi-coloniale. Il y a aussi eu la résistance chinoise lors des deux guerres de l’opium. Il y a eu le soulèvement des Cipayes en Inde en 1857-1858. Cependant, à l’exception peut-être de la révolte des Taiping, ces soulèvements n’avaient pas de programme social en termes d’égalité, de droits des femmes, de choses que nous associons à la gauche, et ils n’étaient pas encore des mouvements de libération nationale. Mais à la fin des années 1860 et dans les années 1870, les soulèvements anticolonialistes ont pris un caractère que l’on pourrait qualifier de gauche ou progressiste.
Marx avait toujours soutenu l’Irlande, mais à la fin des années 1860, il a ouvertement soutenu le mouvement fenian – dont une partie a ensuite donné naissance à l’IRA – et son nationalisme de gauche. À cette époque, les fenians étaient quelque peu éloignés de l’Église et luttaient pour l’émancipation des paysans ainsi que pour l’émancipation nationale. Puis, vous passez à la Russie, qui, à ses yeux, était un pays réactionnaire : elle avait agi comme une force contre-révolutionnaire contre le soulèvement austro-hongrois de 1848, et Marx la considérait comme le gendarme de l’Europe. Après les soulèvements paysans des années 1850, l’abolition du servage en 1861 et la réforme agraire qui l’accompagna en Russie, le mouvement populiste émergea dans les années 1870. Ce sont les populistes [qui voyaient dans la paysannerie et non dans la classe ouvrière l’agent de la révolution socialiste en Russie] qui commencèrent à traduire l’œuvre de Marx, qui fut alors largement discutée. Dans le même temps, après la répression de la Commune de Paris en 1871, le mouvement ouvrier en Europe occidentale a connu un déclin jusqu’à la création de la Deuxième Internationale, six ans après la mort de Marx, en 1889.
Si l’on examine empiriquement les possibilités révolutionnaires dans le monde entre 1869 et la mort de Marx en 1883, outre la Commune de Paris qui fut rapidement réprimée en 1871, un immense ferment révolutionnaire est à l’œuvre en Irlande, en Russie et aussi en Inde. Dans les cas de la Russie et de l’Irlande, il existe également un élément de gauche dans les mouvements paysans que Marx considère comme très important.
Grusha Gilayeva : Pouvons-nous alors parler du contexte contemporain : existe-t-il une méthode pour évaluer le potentiel révolutionnaire ou la direction que peut prendre la séquence révolutionnaire ? Pour Marx à la fin de sa vie, comme vous l’expliquez clairement dans Marx at the Margins, cela ne pouvait pas facilement commencer en Angleterre, malgré le fait que ce pays était le centre du capitalisme du XIXe siècle et qu’il comptait la plus grande classe ouvrière.
Kevin Anderson : C’est la partie la plus délicate pour moi et je ne l’ai pas entièrement développée dans mon dernier livre sur Marx. Marx dit à plusieurs reprises que les travailleurs anglais ont les plus grands syndicats ; ils constituent de loin la plus grande classe ouvrière industrielle au monde, aucun autre pays ne pouvant même s’approcher du niveau d’industrialisation de la Grande-Bretagne dans les années 1860-1870. C’est donc là que la révolution doit avoir lieu si elle veut vraiment renverser le capitalisme. En même temps, il dit que les travailleurs anglais ont divers facteurs qui les freinent. L’un d’eux est le préjugé contre les travailleurs irlandais à l’intérieur de la Grande-Bretagne qui, selon ses propres termes, est presque aussi grave que la haine raciale que les Blancs pauvres des États du sud de l’Amérique du Nord éprouvent envers les Noirs anciennement esclaves, ce qui divise la classe ouvrière. Les travailleurs anglais doivent donc être stimulés de l’extérieur par le soutien au soulèvement en Irlande. Puis, à la fin des années 1870 et au début des années 1880, Marx commence à penser que la révolution européenne pourrait commencer en Russie et s’étendre à l’Allemagne et à l’Autriche-Hongrie, puis que les Français, avec leur tradition révolutionnaire, interviendraient d’une manière ou d’une autre. C’est ainsi que la pression, mais aussi l’inspiration venant de l’extérieur, feraient le travail. Mais certains interprètent ce revirement dans la pensée de Marx dans un sens quasi maoïste : les travailleurs anglais seraient racistes et réactionnaires, et tout devrait venir de l’extérieur. Je pense cependant qu’il n’aurait pas consacré autant d’encre aux travailleurs anglais s’il n’avait pas cru en leur potentiel révolutionnaire. Après tout, Marx était engagé auprès des travailleurs anglais. Ceux-ci avaient un potentiel révolutionnaire, mais la révolution était plus complexe et devait nécessairement être internationale.
Comment pouvons-nous en être presque sûrs ? Parce que si, en 1869-1870, Marx écrit à quel point la conscience des travailleurs anglais est déformée, six ans auparavant, il louait encore la classe ouvrière anglaise et sa conscience. Pourquoi ? Parce que pendant la guerre civile américaine, les travailleurs anglais n’ont pas soutenu l’intervention anglaise dans le Sud pour le séparer des États-Unis et permettre à l’Angleterre de continuer à s’approvisionner en coton. Les ouvriers s’opposaient à l’intervention aux côtés du Sud, même au prix de perdre leur emploi, car la guerre civile américaine plongeait les usines textiles dans une crise industrielle majeure, celles-ci ne pouvant plus s’approvisionner en coton. Il ne pouvait donc pas, en l’espace de six ou sept ans, avoir décidé que les ouvriers anglais étaient désormais totalement réactionnaires. Ainsi, le point important n’est pas que Marx cesse tardivement de réfléchir au potentiel socialiste des classes ouvrières dans des pays comme l’Angleterre, la France et les États-Unis, mais qu’il complique [sa compréhension du processus révolutionnaire] en termes de difficultés qui se posent pour développer cette conscience révolutionnaire ainsi que la motivation et le programme de la victoire. Il voit également des possibilités révolutionnaires différentes à travers le monde, de manière plus large qu’il ne l’avait jamais fait auparavant.
Grusha Gilayeva : Alors que nous parlons de ces contradictions complexes, j’aimerais soulever la question du rôle de la Russie dans le capitalisme contemporain, car, comme vous le dites, Marx était attentif à ce qui se passait en Russie. Ce pays n’était pas industrialisé, il était assez réactionnaire et Marx le considérait comme une forme de puissance impérialiste. Trente-cinq ans après la mort de Marx, l’empire russe s’est effondré sous le poids de ses propres contradictions, exacerbées par la Première Guerre mondiale interimpérialiste, et a été remplacé par l’Union soviétique, qui a servi de centre d’attraction pour les mouvements socialistes et communistes du tiers monde, parallèlement et en concurrence avec la Chine après la rupture sino-soviétique dans les années 1960. La Russie de Poutine, issue de la démocratie de marché mutilée par Eltsine, est toujours considérée par la gauche comme une sorte de force anti-impérialiste progressiste. Quel est votre point de vue sur le rôle de la Russie dans le capitalisme et la politique contemporains à la lumière de son invasion à grande échelle de l’Ukraine ?
Kevin Anderson : Je pense que l’une des caractéristiques du
poutinisme, l’idéologie du régime actuel en Russie, est ce mélange étrange entre l’ancien nationalisme slavophile du XIXe siècle et le néo-stalinisme.
On pourrait dire qu’aujourd’hui, Staline et Alexandre Soljenitsyne, le plus grand ennemi de l’Union soviétique, sont tous deux de grands héros de l’État russe actuel. La Russie est-elle une puissance impérialiste ? Oui. Son pouvoir est principalement régional, ce n’est donc pas comme dans les années 1950, lorsque l’Union soviétique était une grande puissance militaire, politique et économique. Elle était également un modèle attrayant pour certaines personnes. Je ne pense pas que cela existe aujourd’hui. Mais même si la Chine est la deuxième puissance économique mondiale, la Russie est la deuxième puissance militaire. Même si sa technologie est un peu dépassée, la Russie dispose toujours de toutes ces ogives nucléaires et de la capacité de les lancer.
Mais il y a un autre élément important que vous évoquez dans votre question et qui s’applique à l’ensemble du groupe BRICS. Même si ces pays constituent un contrepoids à l’hégémonie américaine, qu’est-ce que cela signifie ? Leurs politiques sont généralement néolibérales. Qu’est-ce que cela signifie pour un pays africain, par exemple ? Au lieu d’avoir la Légion étrangère française, ils auront le groupe Wagner. N’est-ce pas une grande amélioration ? Ce n’est pas Che Guevara, ni même la Révolution culturelle de Mao qui, aussi horrible qu’elle ait été, prétendait au moins changer les relations humaines de manière radicale. Non, c’est comme si nous voulions une plus grande part du gâteau, mais que nous voulions que le gâteau ait exactement le même goût, le même glaçage et tout le reste. C’est bien sûr la faiblesse de la gauche qui la conduit à ce genre de raisonnement.
Cela nous rend malheureux de voir les États-Unis aider Israël à marteler l’Iran sans que rien ne semble pouvoir s’y opposer. Il y a un désir ardent de voir quelqu’un défier les États-Unis et leurs alliés. Les personnes qui sont mécontentes de l’impérialisme américain voient Poutine envahir l’Ukraine et la Chine montrer sa puissance économique et ne pas se soumettre aux droits de douane américains. Il y a une raison pour laquelle les gens disent : « C’est bien, au moins ils ne peuvent pas faire tout ce qu’ils veulent », mais il n’y a aucun programme positif là-dedans.
Cela nous ramène à la raison pour laquelle Marx était si enthousiaste à propos de la Russie dans les années 1870. Bien sûr, il voyait les intellectuels en contact avec les mouvements révolutionnaires qui se formaient, traduisant Le Capital et en débattant, mais son intérêt pour la commune villageoise ou le mir ne signifie pas qu’il pensait que le soulèvement paysan s’ajouterait simplement au mouvement socialiste occidental afin d’affaiblir un peu le système. Ce qu’il voyait dans la communauté paysanne, c’était un véritable projet communiste en puissance. Il prend toutefois bien soin de préciser qu’il ne pense pas que le village communautaire russe puisse être défendu et développé uniquement sur ses propres bases, en rejetant les influences étrangères et capitalistes. Il dit très clairement qu’il doit s’allier au mouvement ouvrier révolutionnaire occidental et à la technologie moderne…
Grusha Gilayeva : Vous citez les sociétés communautaires indigènes ainsi que les communes paysannes parmi les sujets révolutionnaires potentiels étudiés par Marx à la fin de sa vie. Qu’est-ce que cela signifie pour la stratégie révolutionnaire de la gauche aujourd’hui ? Étant donné qu’en Russie, par exemple, le nombre d’autochtones est en baisse constante ?
Kevin Anderson : Eh bien, partout. Je veux dire, il y a des exceptions comme la Bolivie, qui a, je crois, une majorité autochtone qui parle peut-être d’autres langues que l’espagnol comme première langue. Pour être précis, je parle des populations rurales, car le village russe n’était pas [ce que nous entendons aujourd’hui par] une communauté autochtone. Les différentes formes de communisme prémoderne qui persistent sous différentes formes sont très intéressantes. Lorsque les gens quittent les zones rurales pour s’installer dans les villes, ils emportent avec eux des sensibilités différentes. Si l’on prend l’exemple de la Turquie, le pouvoir d’Erdogan s’explique souvent par son appui sur la population rurale récemment urbanisée, qui est considérée comme favorable à l’islam politique, à l’interdiction de l’alcool et au port du voile pour les femmes. Si cela est vrai, il y a ce côté rural et même certaines populations autochtones, mais il y a aussi l’autre côté : un sens plus fort de l’identité collective et de la solidarité sociale, par opposition à l’individualisme bourgeois. Ces populations nouvellement prolétarisées apportent avec elles leurs propres formes de coopération et de solidarité.
Cela renvoie également à un vieux débat au sein même du prolétariat occidental : qui sont les travailleurs les plus révolutionnaires dans une ville comme Chicago ? S’agit-il des ouvriers allemands qualifiés d’origine américaine(nés aux EU), comme les frères Reuther – et surtout ceux qui se situaient plus à gauche qu’eux –, qui étaient des ouvriers industriels de deuxième ou troisième génération, qualifiés, engagés dans les mouvements syndicaux et lecteurs de littérature socialiste ? D’accord, il y a du vrai dans cela : ce sont les travailleurs « avancés », comme on les appellerait dans le lexique socialiste. Mais qu’en est-il de personnes comme mon ancien camarade Charles Denby, auteur de Indignant Heart, a Black Worker’s Journal ? Il est arrivé à Detroit en 1943, en pleine guerre ; il ne savait même pas ce que signifiait le mot « grève ». Mais il y a beaucoup de travailleurs noirs qui arrivent du Sud et ils sont vraiment en colère parce qu’ils pensent qu’ils seront libres dans le Nord et ils sont choqués quand ils découvrent qu’ils ne le sont pas. Denby lance donc une grève en disant que les travailleurs doivent tous quitter leur emploi en même temps parce qu’il y a beaucoup de travail dans la rue et ils obligent la direction à accepter leurs conditions. Quels sont les travailleurs les plus révolutionnaires ? Dans cette situation, les nouveaux travailleurs noirs. Mais je pense que nous avons besoin des deux. Nous n’aurions pas cette conversation si nous ne pensions pas qu’il est important pour les mouvements sociaux de conserver une grande partie de ces discussions et traditions, car aucun de nous n’est un pur universitaire, aucun n’est lié au militantisme. En même temps, je pense que
nous devons reconnaître que certaines des luttes les plus révolutionnaires viennent de personnes qui ne connaissent même pas le vocabulaire socialiste.
Grusha Gilayeva : Je me demande simplement si l’on peut tirer une méthode ou des critères de la trajectoire de la pensée de Marx telle que vous l’avez décrite. Quand il s’agit de réfléchir aux sujets et aux alliés dans la lutte pour un changement révolutionnaire. Lénine s’est servi de la lettre de Marx à Meyer et Vogt pour affirmer que le prolétariat d’une nation oppressive devait soutenir la lutte d’une nation opprimée pour son autodétermination. Pensez-vous que nous devons revenir à Marx pour légitimer de telles affirmations ou pensez-vous que Marx est utile pour trouver une méthode permettant d’établir de telles distinctions ?
Kevin Anderson : Je veux dire que Marx n’est plus une figure d’autorité, probablement nulle part, même s’il est peut-être plus respecté dans quelques grands pays comme le Brésil ou l’Inde, et bien sûr dans quelques petits pays. Il y a encore beaucoup d’intellectuels et de mouvements sociaux marxistes dans ces pays. Je laisse de côté la Chine, où le marxisme relève davantage du carriérisme que d’une véritable adhésion à la pensée marxiste. Lénine a peut-être été le premier à utiliser le terme « mouvements de libération nationale ». S’agit-il d’un mouvement nationaliste ? Il est anti-impérialiste, mais est-il libérateur ? Est-il réactionnaire ? Ou est-ce une combinaison des deux ? Marx et Engels utilisent déjà dans le Manifeste communiste une phrase qui semble s’opposer à tout nationalisme : « Les travailleurs n’ont pas de patrie ». Et pourtant, dans les dernières pages du Manifeste, ils insistent également sur le fait que la classe ouvrière doit soutenir la Pologne et sa quête d’indépendance en tant que nation. Marx ne le dit pas, mais je pense que dans mon livre A Political Sociology of Twenty-First Century Revolutions, le genre est souvent utilisé comme un très bon test révélateur. C’est l’un des moyens de distinguer les mouvements plus fondamentalistes comme ceux de l’ayatollah iranien ou des Frères musulmans, qui sont anti-impérialistes et soutiennent les Palestiniens, mais dont le contenu sociopolitique est, entre autres, conservateur au mieux. Et puis, il y a des mouvements explicitement de gauche, que la gauche mondiale peut très facilement soutenir, comme le Rojava en Syrie. Mais lorsque des soulèvements gigantesques comme le Printemps arabe ont eu lieu, ils n’étaient pas explicitement de gauche, mais ils n’étaient certainement pas fondamentalistes ou islamistes. Ces jeunes, et même ceux qui venaient des groupes islamistes, n’étaient pas comme en Iran en 1978. « L’islam est la solution » n’était pas le slogan scandé dans les rues de Tunisie ou d’Égypte en 2011. Lorsque nous examinons divers mouvements anti-impérialistes, nous pouvons souvent utiliser le genre – ainsi que la classe, bien sûr – pour nous aider à les évaluer.
Grusha Gilayeva : Dans Political Sociology, vous soulignez également le lien entre la lutte du peuple palestinien contre Israël et celle du peuple ukrainien contre l’agression russe. Comment est-il possible d’établir ce lien ? Cela semble aller à l’encontre de la position dominante de la gauche américaine. Si tout le monde s’accorde à soutenir la Palestine, l’opinion est totalement différente lorsqu’il s’agit de l’Ukraine.
Kevin Anderson : Eh bien, d’un point de vue purement empirique, nous pouvons parler de la répression sévère qui sévit actuellement dans des pays comme le Myanmar/Birmanie, où le soulèvement est violemment réprimé par l’armée. Mais même là-bas, l’armée ne dit pas qu’elle va se débarrasser du peuple birman. Alors que les Israéliens et les États-Unis sous Trump, d’un côté, et les Russes et les Biélorusses, de l’autre, nient à des peuples entiers leur droit à l’existence. La Russie dit : « L’Ukraine n’existe même pas vraiment en tant que pays. Elle n’a jamais existé. L’ukrainien n’est qu’un dialecte du russe. Et ceux qui pensent qu’elle existe sont tous des fascistes et des nazis. C’est pourquoi ils doivent être exterminés. » Et Trump et les Israéliens affirment de plus en plus qu’ils pourraient expulser tous les Palestiniens, non seulement de Gaza, mais aussi de Cisjordanie, pour les envoyer on ne sait où, mais les chasser, voire pire. Il est donc compréhensible que notre gauche se préoccupe de la Palestine, car nous finançons, conseillons militairement et soutenons la guerre à Gaza par le biais de notre gouvernement et de toutes nos institutions. Il est également compréhensible que, dans les médias grand public, les Ukrainiens soient présentés comme des héros pour des raisons géopolitiques. Mais ces luttes sont très similaires.
J’ai vu la petite gauche au sein de la communauté ukrainienne. Et il y a une petite gauche dans la communauté russe en exil.
Je vois ces groupes ukrainiens de gauche prendre des résolutions sur la Palestine, mais je ne vois pas les groupes pro-palestiniens en Occident prendre des résolutions et manifester leur soutien à l’Ukraine. Au contraire, je les vois rester silencieux.
C’est très regrettable. Mais c’est la bataille qui doit être menée si nous adoptons une vision plus globale. Après la fameuse rencontre à la Maison Blanche entre Zelensky et Trump, les États-Unis ont retiré leur soutien à l’Ukraine. Sans cette aide extérieure, nous pourrions voir une partie importante du territoire ukrainien être lentement annexée. Je ne pense pas qu’ils puissent être conquis, mais ils peuvent être divisés.
Et c’est vraiment horrible, car le manque de soutien éloigne les Ukrainiens et les pro-Ukrainiens de la gauche. Plus quelqu’un comme Zelensky dit « nous soutenons Israël parce que son projet de lutte contre le terrorisme et la violence est le même que le nôtre », plus il est difficile pour la gauche de soutenir l’Ukraine. Il est certain que les trumpistes n’ont aucun mal à voir la similitude entre l’Ukraine et la Palestine, puisqu’ils veulent écraser les deux. Je n’exagérais pas dans le livre quand je disais que ce sont des luttes pour l’existence même de ces nations. Et nous voyons Trump du mauvais côté dans les deux cas. Peut-être que cela réveillera un peu les gens.
Je pense que le fait que même la gauche ne puisse pas faire plus est un signe de la nature réactionnaire de notre époque. Je me souviens de 1968 en Tchécoslovaquie ou de 1980 en Pologne, et comment une plus grande partie de la gauche mondiale soutenait alors la Pologne et la Tchécoslovaquie qu’elle ne soutient aujourd’hui l’Ukraine. La gauche elle-même était beaucoup plus importante à l’époque. Et bien sûr, quand la gauche est plus importante, cela signifie qu’elle dispose d’une base sociale plus large. Si vous avez un groupe de quelques milliers de personnes fortement attachées à un certain type de politique, vous pouvez soutenir implicitement ou explicitement des régimes comme celui d’Assad en Syrie ou même la Corée du Nord sans perdre beaucoup de monde. Mais si vous avez une base dans la classe ouvrière ou une autre force sociale importante, elle va quitter votre parti, comme cela s’est produit avec le Parti communiste français après 1956 et 1968.
Grusha Gilayeva : Pensez-vous qu’il existe une tendance à gauche à assimiler l’État au peuple ? Beaucoup de gens à gauche considèrent que Vladimir Poutine représente en quelque sorte le peuple russe, malgré toutes les élections truquées qu’il a organisées. Zelensky incarne également la volonté du peuple ukrainien et, curieusement, le Hamas incarne aussi la volonté du peuple palestinien. Mais cette tendance ne s’applique pas aux États-Unis, où personne ne nie que le fossé entre une partie du peuple et le gouvernement ne pourrait être plus grand.
Kevin Anderson : Cette façon de penser remonte au moins au stalinisme. Les staliniens affirmaient très clairement que certains peuples étaient presque toujours révolutionnaires et d’autres réactionnaires. Par exemple, les Tchétchènes étaient considérés comme réactionnaires et ont donc été déportés vers le Kazakhstan. Dans un discours prononcé au début des années 1930, Staline affirmait que le peuple russe, et non le peuple soviétique, était le plus révolutionnaire. Et bien sûr, si nous sommes révolutionnaires, alors si nous allons en Ukraine, c’est que nous faisons quelque chose de bien. Il y a donc cette tendance à marginaliser, et je pense que plus on s’éloigne du soi-disant centre occidental, plus il devient facile, aux yeux des cultures dominantes mondiales, de le faire. Il est difficile pour les gens, à cause de l’orientalisme et autres, de voir le peuple palestinien comme différent. Je travaille beaucoup sur l’Iran et il est très difficile pour les gens [aux États-Unis] de voir la population iranienne comme différente en ce sens.
C’est un problème majeur, et c’est bien sûr là que la classe sociale prend toute son importance. Toutes les sociétés que je connais dans le monde aujourd’hui ont des classes dirigeantes. D’après ce que nous pouvons en juger, la Chine est peut-être le pays qui présente les plus grandes inégalités économiques parmi les nations vraiment puissantes. Elle compte également de nombreux milliardaires, alors que la population dans son ensemble est beaucoup plus pauvre que dans les pays occidentaux. Le fossé économique en Chine est donc en réalité plus important qu’en France ou aux États-Unis. Nous savons également, grâce à l’indice de Gini, que l’Afrique du Sud est le pays le plus inégalitaire au monde. Même dans les années 1960, on n’entendait pas beaucoup parler de classe dans le cadre des mouvements anti-impérialistes. Et l’Ukraine ne s’oppose même pas à l’impérialisme de l’UE et de l’Amérique du Nord, contrairement à Poutine qui prétend le contraire. Il y a une raison supplémentaire pour laquelle cela est regrettable, car si nous pouvions un jour devenir plus importants que nous ne le sommes actuellement, il serait très difficile, en tant que gauche, de dire que nous soutenons le socialisme démocratique sans pouvoir nous prononcer sur les actions de Poutine en Ukraine, ou que nous ne pouvons pas critiquer le régime iranien parce que ce n’est pas le bon moment, alors qu’il est sous le feu des critiques d’Israël et des États-Unis. Cela est lié au type de société que nous souhaitons avoir. L’une des raisons pour lesquelles nous soutenions la Tchécoslovaquie quand j’étais jeune était que nous nous opposions au socialisme officiel de l’URSS. Si vous ne faites pas cela, vous finissez par proposer un projet intellectuel et politique vraiment obscur.
Une dernière chose : aux États-Unis, nous faisons partie de cet appareil impérialiste géant ; pendant des décennies, notre gouvernement n’a cessé de juger les autres pays – même si le trumpisme a rendu cette attitude plus cynique – en les qualifiant de non démocratiques, etc. En réponse, la gauche estime également que nous n’avons donc pas le droit de critiquer la Chine ou d’autres États, comme si cela était antisocialiste ou antimarxiste. Mais notre analyse des classes, du genre ou de l’ethnicité doit-elle s’arrêter aux frontières des États-Unis, de l’Union européenne et du Japon ? Ou pouvons-nous l’appliquer à des endroits comme la Chine, la Russie ou le Moyen-Orient ? Bien sûr que oui.
Sinon, il y aura toujours des forces de gauche ou progressistes dont nous n’entendrons pas parler. Nous devons au contraire les soutenir dans tous les pays du monde. Agir autrement reviendrait à rompre avec Marx et le meilleur de la tradition marxiste.
Grusha Gilayeva : Je suis heureuse que vous mentionniez l’Iran, car la position à adopter face à la situation actuelle est très difficile à déterminer. D’un côté, il y a une sorte d’anti-impérialisme réductionniste qui dirait que toute action contre le régime iranien revient à soutenir la présence américaine au Moyen-Orient. De l’autre, il y a une autre position réductionniste, partagée par une partie des émigrés iraniens, qui soutiendrait toute forme d’intervention et de renversement du régime en Iran, même si cela impliquait la destruction totale du pays. Il semble y avoir deux positions opposées, et aucune des deux ne semble tout à fait juste.
Kevin Anderson : Bien sûr. Je ne vois aucun autre pays du Moyen-Orient qui ait connu autant de soulèvements populaires au cours du siècle dernier, depuis la révolution constitutionnelle de 1906 jusqu’à la période de Mosaddegh dans les années 1950, avec un gouvernement élu mais militant nationaliste, puis la grande révolution de 1978-1979, puis plusieurs mouvements sociaux de grande ampleur, dont le Mouvement vert en 2009 et le soulèvement des femmes et des Kurdes-Baloutches en 2022. Nous devons réfléchir à la complexité et aux différentes forces en présence dans ces mouvements en Iran. Mais je ne pense pas que la population iranienne va réagir positivement à des bombardements. Netanyahu a prononcé un discours dans lequel il a salué le mouvement « femme, vie, liberté » de 2022, puis a souligné le fait que l’armée de l’air israélienne compte des femmes pilotes et que l’une d’entre elles bombardait l’Iran à ce moment-là. Je pense qu’il voyait cela comme une tentative de séduire la population iranienne. Nous savons que la gauche en Iran est moins importante qu’autrefois.
Il existe également des mouvements syndicaux en Iran, bien sûr, et, comme je l’ai mentionné, d’importants mouvements féminins et ethniques.
Grusha Gilayeva : Vous avez déjà évoqué les récentes manifestations contre Trump lors de son défilé militaire du 14 juin. Comment évaluez-vous ces manifestations ? Sont-elles le signe d’un retour vers un certain statu quo libéral ou pensez-vous qu’il soit possible de relier ce mouvement à d’autres luttes au-delà des frontières américaines ?
Kevin Anderson : Bien sûr, ce potentiel existe, car les dirigeants du Parti démocrate se sont vraiment discrédités, d’abord sur la question palestinienne, et maintenant, on voit que beaucoup d’entre eux restent silencieux sur l’intervention américaine en Iran. Si vous regardez le mouvement anti-Trump de 2017, j’ai assisté à la grande manifestation de la Marche des femmes à Los Angeles, et le maire, les sénateurs, tous étaient là, tous prenaient la parole. [Cette fois-ci], en Californie, aucun politicien important ne s’est associé aux manifestations. Cela s’est produit dans certains États, mais ici, les politiciens démocrates ont gardé leurs distances. Mais il ne s’agit pas seulement de la marche, il y a aussi les gens qui descendent dans la rue pour soutenir les immigrants. La présence des troupes ici, à Los Angeles, est une véritable provocation et une partie de la population manifeste tous les jours parce que nous ne voulons pas de ces troupes ici.
Bien sûr, les manifestations se heurtent au problème des grandes institutions, avec le Parti démocrate qui les freine. Quelles sont donc les bases institutionnelles ou sociales de l’opposition ? Les universités ? Harvard a enfin commencé à résister, mais les universités ont beaucoup capitulé, en particulier sur la question palestinienne. Pourquoi les universités ne peuvent-elles pas s’exprimer sur la Palestine ? Parce que les universités publiques de Californie ont besoin du soutien du législateur, et si elles s’expriment sur la Palestine, l’État va réduire leur budget, et les universités le savent. Quelles sont donc les deux plus grandes organisations qui ne reçoivent pas de financement des financiers de Wall Street, qui ne reçoivent pas de financement des fondations libérales, qui ne reçoivent pas de financement du gouvernement ? Les syndicats et les églises. L’Église noire et les autres Églises progressistes, et même dans une certaine mesure l’Église catholique sous les deux derniers papes, se sont exprimées haut et fort sur les droits des immigrants et les droits des travailleurs. Quand on pense à la façon dont l’administration Trump a licencié tous ces fonctionnaires fédéraux, c’est ce que tous les travailleurs redoutent. Et Elon Musk est pour eux le pire cauchemar d’un employeur. Nous avons les jeunes et les communautés latino-américaines qui descendent en masse dans la rue, mais je parle de ces deux groupes parce qu’ils sont bien organisés, bien financés et présents dans tous les États.
Il y a beaucoup d’espoir. Surtout après les manifestations du 1er mai, j’ai commencé à réaliser qu’il y aurait beaucoup plus de résistance. Je suis à l’université de Californie et je pense que l’université de Californie pourrait subir un sort pire encore que celui réservé à Harvard. Je pense simplement qu’ils attendent le moment propice pour agir, et que les prochaines années vont être vraiment horribles. Il faut également s’intéresser à l’Amérique rurale, qui a été un bastion important des partisans de Trump, du moins sur le plan électoral, mais il faut noter que leur proportion dépasse rarement 60 %. Ceux qui s’opposent au fascisme trumpiste peuvent se sentir isolés. Mais le 14 juin, des manifestations ont eu lieu dans ce type de régions. Par exemple, dans la petite ville rurale de Glens Falls, dans l’État de New York, il y a eu une manifestation assez importante. Les anti-Trump dans ces régions, où ils ne voient que des affiches et des autocollants de Trump, se rendent compte qu’ils ne sont pas si peu nombreux. Les gens sont confrontés à beaucoup de répression – regardez ce qui est arrivéau sénateur californien Alex Padilla, qui a été traîné hors d’une conférence de presse et menotté… Cela fait peur aux gens. Mais pensez à tous les habitants d’une petite ville où la plupart des employeurs sont républicains et ont tendance à aimer Trump : si vous allez à un rassemblement dans une petite ville, vous vous exposez et même si vous portez un masque, ils sauront qui vous êtes dans une ville de 15 000 habitants. Les gens vont devoir faire face à cela au travail, être licenciés, en particulier les jeunes. Nous avons déjà vécu cela auparavant, mais jamais à cette échelle.
La situation actuelle avec l’Iran nous pose beaucoup de difficultés, car elle pousse une partie du Parti démocrate à soutenir encore plus Israël et, dans le même temps, alimente les factions les plus sectaires de la gauche. D’un autre côté, une grande partie de la population, y compris la base électorale de Trump, s’oppose à une troisième guerre au Moyen-Orient. Comment peut-on affirmer que les États-Unis doivent s’impliquer et que cette fois-ci, les choses seront différentes ? J’ai entendu un expert militaire sur NPR ce matin qui disait que pour atteindre les installations souterraines, il faudrait envoyer des commandos, et que ceux-ci devraient probablement être américains. Je pense que nous ne vivons pas encore sous un régime fasciste, mais je considère le trumpisme comme un mouvement fasciste, même s’il n’a pas encore complètement pris le contrôle de la société. Il progresse toutefois rapidement, et l’opposition descend également dans la rue. Ne rien faire n’est pas une option, donc que nous ayons ou non une réelle chance de réussir, nous devons quand même agir.
Interview publiée dans POSLE traduction Deepl revue ML
Kevin B. Anderson a grandi dans la région métropolitaine de New York-New Jersey et a fréquenté le Trinity College de Hartford, où il s’est engagé dans les mouvements de justice sociale de la fin des années 1960, notamment Students for a Democratic Society, Hartford’s Other Voice et le Black Panther Defense Committee. Dans les années 1970, il est devenu marxiste-humaniste et universitaire-militant, conduisant un taxi pendant cinq ans à New York, où il a été actif au sein de la Taxi Rank & File Coalition. Il a obtenu un doctorat en sociologie au Graduate Center de la City University of New York en 1983. Il a vécu dans la région de Chicago pendant 25 ans, période durant laquelle il a enseigné aux universités Northern Illinois et Purdue et a été agent littéraire pour la succession de Raya Dunayevskaya. Depuis 2009, il enseigne au département de sociologie de l’université de Californie à Santa Barbara. Il est également actif dans les mouvements de justice sociale dans la région de Los Angeles, où il travaille avec l’Organisation marxiste-humaniste internationale. Parmi ses ouvrages, le plus récent est The Late Marx’s Revolutionary Roads: On Colonialism, Gender, and Indigenous Communism (Verso 2025). Il est également l’auteur de Marx at the Margins: On Nationalism, Ethnicity, and Non-Western Societies et Lenin, Hegel, and Western Marxism (University of Illinois Press, 1995), ainsi que de deux recueils d’essais, Dialectics of Revolution (Daraja Press, 2020) et A Political Sociology of Twenty-First Century Revolutions and Resistances: From the Arab World and Iran to Ukraine, Africa, and France (Routledge 2024). Il écrit régulièrement pour New Politics, The International Marxist-Humanist, LA Progressive et Jacobin sur le marxisme et sur la politique internationale et les mouvements radicaux en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient.
Soutenez-nous, soutenez POSLE

