par Andrea Ferrario
De l’Angola à la Zambie en passant par l’Ouzbékistan : trois cas emblématiques révèlent comment le modèle d’expansion économique chinois suscite une résistance croissante dans le monde
Trois cas emblématiques mettent en évidence les mécanismes prédateurs du modèle d’expansion économique chinois à l’échelle mondiale, où les investissements dans les infrastructures et la pénétration commerciale s’accompagnent systématiquement d’une dégradation de l’environnement, de violations des droits des travailleurs et d’une hostilité croissante des populations locales. Les événements dramatiques qui se sont récemment déroulés en Angola et en Zambie montrent comment la stratégie de Pékin, fondée sur des accords avec les élites politiques et le mépris des besoins des populations locales, génère une spirale de tensions qui menace la viabilité même de la présence chinoise sur le continent africain, tandis que des phénomènes de résistance similaires apparaissent également en Asie centrale, confirmant l’ampleur géographique d’un ressentiment qui traverse différents continents.
L ‘Angola dans le chaos : la révolte anti-chinoise bouleverse l’équilibre en Afrique
La présence économique chinoise en Angola, construite au cours de plus de deux décennies d’investissements massifs et d’accords de coopération stratégique, est confrontée à sa crise la plus grave depuis le début du nouveau millénaire. Une violente vague de protestations a transformé ce qui semblait au départ être une grève normale des chauffeurs de taxi contre la hausse des prix du carburant en une révolte explicitement anti-chinoise qui a ébranlé les fondements de la coopération sino-angolaise. Le syndicat ANATA avait organisé une manifestation de trois jours contre la décision du gouvernement d’augmenter le prix de l’essence, mais la colère populaire s’est rapidement dirigée contre les symboles les plus visibles de l’influence économique de Pékin dans le pays. Les rues de Luanda et de la province de Malanje sont devenues le théâtre d’une révolte qui a spécifiquement visé les activités commerciales et industrielles gérées par des citoyens chinois, révélant le profond ressentiment accumulé par la population locale à l’égard du géant asiatique.
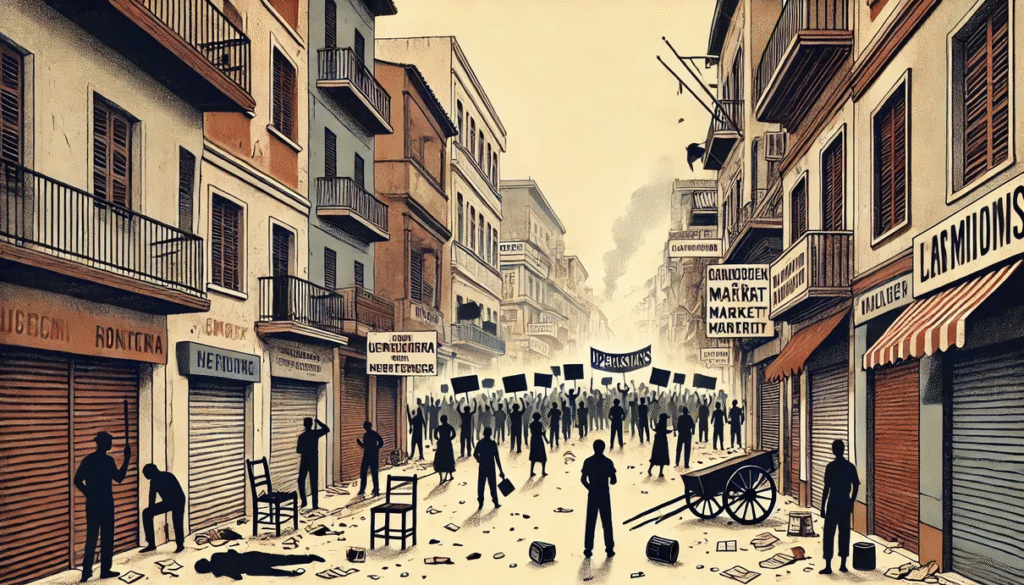
La fureur populaire s’est abattue avec une violence particulière sur les intérêts économiques chinois entre juillet et août, transformant une protestation sociale en une attaque systématique contre la présence de Pékin en Angola. Plus de quatre-vingt-dix magasins appartenant à des Chinois ont été vandalisés, tandis que plusieurs usines ont dû suspendre immédiatement leur production et fermer leurs portes pour des raisons de sécurité. La violence s’est particulièrement concentrée sur les chaînes de vente au détail. Les images diffusées en ligne montrent des commerçants chinois terrifiés qui se barricadent dans leurs magasins tandis que des foules en colère détruisent les vitrines, pillent les marchandises et saccagent l’intérieur des commerces. La violence a atteint un tel niveau qu’elle a paralysé des zones industrielles entières gérées par des entreprises chinoises, avec des portes fermées et une production complètement arrêtée.
L’escalade de la violence a déclenché un exode sans précédent de la communauté chinoise d’Angola, provoquant la fuite de l’une des plus grandes diasporas de Pékin sur le continent africain. Des milliers de citoyens chinois ont quitté précipitamment le pays, provoquant des scènes de panique à l’aéroport international de Luanda, où les vols vers la Chine étaient complètement complets. La communauté chinoise locale, estimée entre 250 000 et 300 000 personnes, a vécu des heures dramatiques, beaucoup de personnes étant contraintes de se réfugier dans des complexes surveillés ou de fuir par voie terrestre vers les pays voisins. Les ambassades chinoises ont diffusé des avis d’urgence exhortant tous leurs compatriotes à quitter immédiatement le territoire angolais. Le bilan final d’au moins cinq morts et plus de 1 200 arrestations témoigne de la gravité d’une crise qui a pris complètement au dépourvu la stratégie diplomatique de Pékin en Afrique.
Le modèle chinois de pénétration économique en Angola, construit dans le cadre de l’initiative « Belt and Road » avec 68,6 milliards de dollars de prêts accordés entre 2000 et 2021, montre toutes ses contradictions structurelles. L’ Angola est devenu le principal bénéficiaire africain du projet d’infrastructure chinois, qui a financé la construction de routes, de chemins de fer, d’hôpitaux et du nouvel aéroport international Dr Antonio Agostinho Neto, considéré comme le plus grand aéroport financé par la Chine en dehors de ses frontières nationales. Cependant, ce développement a créé un système économique dualiste où les avantages sont concentrés entre les mains d’une élite restreinte liée aux intérêts chinois, tandis que la grande majorité de la population angolaise reste exclue des bénéfices de la croissance. Le mécanisme de remboursement de la dette par les exportations pétrolières a également créé une dépendance structurelle qui devient insoutenable, d’autant plus que Pékin a réorienté ses importations énergétiques vers la Russie et le Moyen-Orient.
Les incidents qui ont alimenté le ressentiment anti-chinois révèlent un modèle systématique de comportements inacceptables de la part des entreprises de Pékin sur le territoire angolais. En 2024, les autorités locales ont fermé deux usines chinoises pour violation grave des lois nationales : une usine de transformation des métaux qui opérait sans licence et avait pollué une rivière locale, et une usine de plastique qui maintenait 113 employés angolais dans des conditions de travail inhumaines, pratiquement prisonniers à l’intérieur de l’usine. À ces scandales se sont ajoutées les protestations des pêcheurs locaux contre les bateaux de pêche chinois accusés de dévaster les réserves halieutiques locales, et la récente opération gouvernementale qui a conduit à la fermeture de 25 opérations illégales d’extraction de cryptomonnaies gérées par des citoyens chinois, aboutissant à l’expulsion de 60 personnes impliquées dans des activités interdites en raison de leur impact sur le fragile réseau électrique national. Ces incidents ont contribué à consolider l’image de la Chine en tant que puissance extractive et prédatrice plutôt qu’en tant que partenaire capable d’offrir un développement.
La crise angolaise marque un tournant potentiel pour l’expansion chinoise en Afrique, mettant brutalement en évidence les limites d’une stratégie basée exclusivement sur les investissements infrastructurels et les accords avec les élites politiques locales. Pour Pékin, qui a fait de l’Angola un pilier de sa présence sur le continent africain, la leçon est claire : le soft power ne peut se construire en ignorant les dynamiques sociales et les attentes des populations locales. Le modèle sino-angolais, souvent présenté comme un exemple vertueux de coopération Sud-Sud, a révélé son insoutenabilité structurelle face à la colère populaire. Les événements de Luanda pourraient donc déclencher une réaction en chaîne dans d’autres pays africains où la présence chinoise génère des tensions similaires, mettant Pékin en crise.
Zambie : quand une catastrophe environnementale révèle le vrai visage de l’investissement chinois
La crise angolaise n’est pas un cas isolé dans les relations complexes entre la Chine et l’Afrique, comme le montrent les récents développements en Zambie, où une catastrophe environnementale aux proportions catastrophiques a mis en évidence les effets dévastateurs du modèle d’investissement chinois sur le continent. En février, l’effondrement partiel d’un barrage de résidus miniers près de la mine de cuivre appartenant à l’entreprise publique chinoise Sino Metals Leach Zambia, près de la ville de Kitwe, a libéré dans l’environnement environ 1,5 million de tonnes de déchets toxiques chargés de métaux lourds, de cyanure et d’acides concentrés. L’ampleur de la catastrophe, initialement sous-estimée par les autorités, s’est avérée trente fois supérieure aux estimations initiales, avec plus de 900 000 mètres cubes de déchets toxiques qui continuent de contaminer le bassin du fleuve Kafue, artère vitale pour plus de 12 millions de Zambiens qui dépendent de ses eaux pour la pêche, l’agriculture et l’approvisionnement en eau. L’affaire a pris une tournure encore plus grave avec la découverte, quelques jours après le premier accident, d’une deuxième fuite de déchets acides provenant d’une autre mine chinoise dans la ceinture de cuivre zambienne, dont les exploitants avaient tenté de dissimuler l’incident.
Les conséquences juridiques et économiques de la catastrophe prennent des proportions énormes, deux cabinets d’avocats ayant déposé des demandes d’indemnisation pour un montant total de 420 millions de dollars à l’encontre de la société chinoise. La société Drizit Environmental, initialement chargée par Sino Metals d’évaluer l’impact environnemental, a été licenciée après avoir révélé l’ampleur réelle de la catastrophe, tandis que plusieurs ambassades ont déconseillé à leurs ressortissants de se rendre dans la zone contaminée en raison des risques sanitaires graves. Le gouvernement zambien, qui avait initialement tenté de minimiser la menace, a été contraint d’admettre la présence de métaux lourds à des niveaux dangereux dans les échantillons d’eau analysés.
L’accident zambien représente un test crucial pour la stratégie chinoise en Afrique, révélant à quel point l’équilibre entre dépendance économique et durabilité environnementale est fragile dans les relations sino-africaines. La Zambie, qui doit à la Chine au moins 4,1 milliards de dollars sur les 13 milliards de sa dette extérieure totale, se trouve dans la position difficile de devoir trouver un équilibre entre les critiques environnementales et la nécessité de maintenir les flux d’investissements chinois qui génèrent 260 millions de dollars par an en taxes. Les tensions entre les travailleurs zambiens et les entreprises chinoises ont une longue histoire de violence, avec des incidents allant de la fusillade de 2010 au cours de laquelle des cadres chinois ont blessé 11 ouvriers zambiens, au meurtre d’un cadre chinois en 2012 par des travailleurs non rémunérés. Malgré les promesses d’une plus grande responsabilité sociale, Pékin a répondu à la catastrophe environnementale par une stratégie médiatique mettant l’accent sur l’aide humanitaire et les nouveaux investissements, tels que les 50 000 dollars de dons aux victimes des récentes inondations et l’investissement annoncé de 1,4 milliard de dollars pour moderniser la ligne ferroviaire Tanzanie-Zambie, en évitant soigneusement toute référence à la catastrophe environnementale dans les médias d’État chinois.
Ouzbékistan : saisies de terres agricoles et dépendance croissante vis-à-vis de Pékin
Les tensions anti-chinoises s’étendent au-delà des frontières africaines, atteignant également l’Asie centrale où l’Ouzbékistan a connu au cours du premier semestre 2025 une campagne médiatique coordonnée qui a révélé le mécontentement croissant de la population à l’égard de la présence économique de Pékin. L’offensive a été principalement orchestrée par des figures de l’opposition ouzbèke en exil, l’ancien imam Fazliddin Shahobiddin ayant publié depuis la Turquie des vidéos accusatrices sur la « vente de l’Ouzbékistan à la Chine », tandis que la chaîne YouTube Demokrat Uz diffusait des contenus dénonçant l’« invasion pacifique » chinoise. Bien que le gouvernement ouzbek ait rapidement démenti les accusations les plus spécifiques et qualifié l’ensemble de la campagne de « manipulation contrôlée par des tiers », la résonance médiatique a mis en évidence des préoccupations réelles qui couvaient depuis longtemps au sein de la population locale. Contrairement aux cas africains caractérisés par des violences spontanées et des catastrophes environnementales, en Ouzbékistan, le mécontentement s’est manifesté par une guerre de l’information qui a néanmoins mis en évidence les contradictions du modèle d’investissement chinois dans un pays stratégiquement crucial pour l’initiative Belt and Road.
Derrière les campagnes susmentionnées se cachent des dynamiques concrètes qui reflètent dans une certaine mesure les modèles observés en Afrique, à la différence notable que le gouvernement ouzbek continue de protéger activement son partenariat avec Pékin en raison de sa dépendance économique. Les sondages du Central Asia Barometer font état d’une chute de la perception positive de la Chine, qui est passée de 70 % en 2017 à 44 % en 2023, chute qui coïncide avec l’explosion des investissements chinois après l’ouverture du pays voulue par le président Mirziyoyev en 2016. Des événements concrets ont alimenté les craintes populaires, comme la découverte en 2025 du transfert forcé de plus de 25 000 hectares de terres agricoles à des entreprises chinoises dans les provinces d’Andijan et de Qashqararyo, sans explication officielle et touchant des centaines d’agriculteurs. La situation s’est aggravée lorsqu’un fonctionnaire local de Samarcande a été enregistré alors qu’il menaçait de « céder les terres aux Chinois » si les agriculteurs n’étaient pas plus productifs, alimentant les soupçons d’un plan systématique d’acquisition territoriale.
Le cas ouzbek illustre comment le modèle chinois de pénétration économique suscite des résistances même dans des contextes où les autorités locales maintiennent une façade de coopération, démontrant que le problème dépasse les incidents individuels et touche à des questions structurelles. La Chine, qui ne reconnaît pas officiellement l’existence de sentiments anti-chinois en Asie centrale, a déjà dû adopter des stratégies de communication plus sophistiquées dans les pays voisins, le Kazakhstan et le Kirghizistan, où des dizaines de manifestations anti-chinoises ont eu lieu ces dernières années. Le phénomène ouzbek confirme que le mécontentement envers la présence chinoise prend une dimension mondiale, touchant différents continents mais avec des dynamiques étonnamment similaires d’exploitation des ressources, de concentration des bénéfices entre les mains des élites locales et d’exclusion des populations autochtones des avantages de la croissance économique.
Andrea Ferrario est un blogueur italien spécialisé dans la politique internationale, avec un accent particulier sur l’Asie de l’Est. Il a collaboré avec l’hebdomadaire Internazionale et est co-rédacteur en chef du site Crisi Globale.
Cet article a été initialement publié sur Substack de l’auteur.
Traduction française deep revue ML pour Réseau Bastille.

